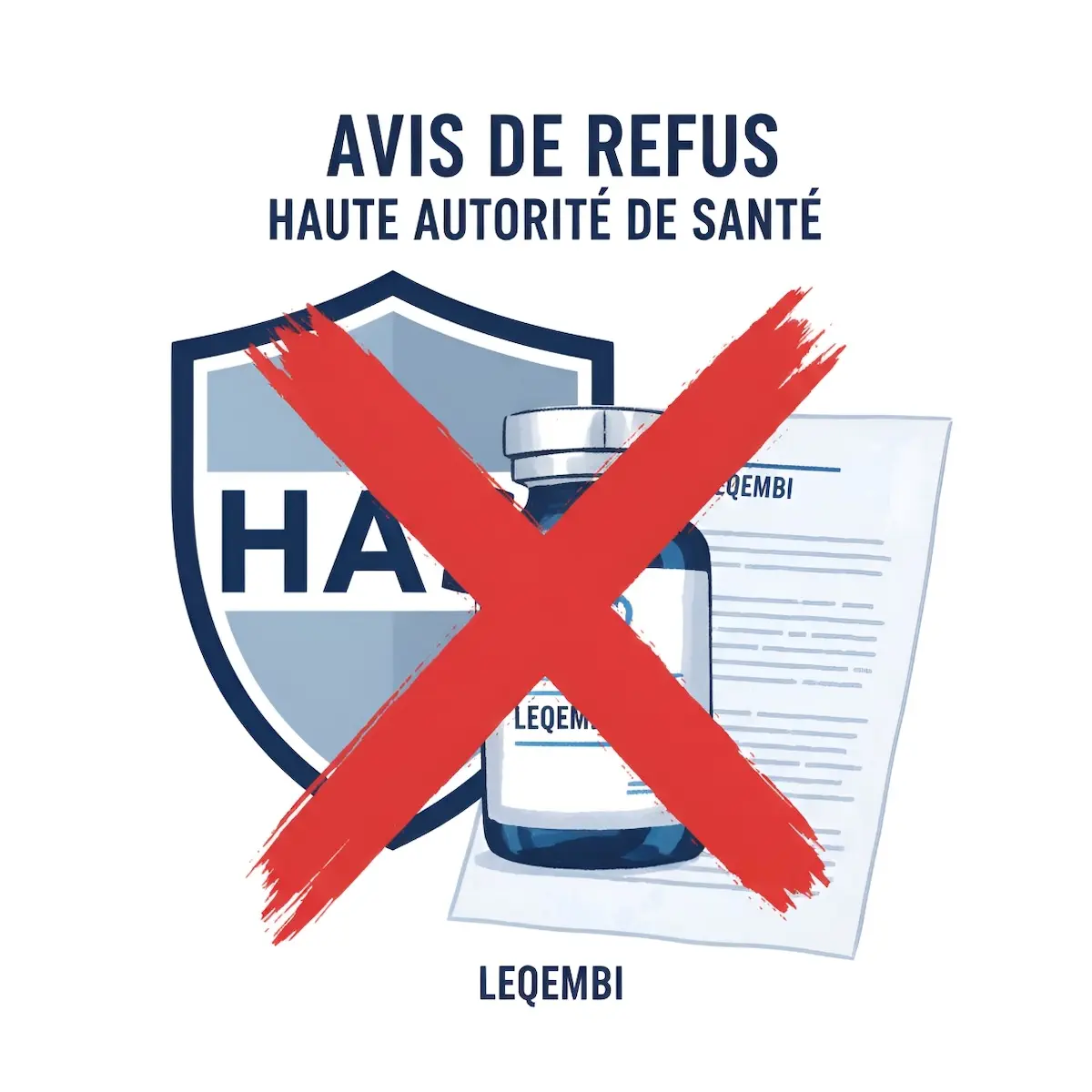Cette décision est un coup dur pour les 1,2 million de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en France. Le 9 septembre 2025, la Haute Autorité de Santé a dit non au Leqembi, ce nouveau médicament qui avait pourtant été approuvé par les autorités européennes quelques mois plus tôt.
Cette immunothérapie, développée par les laboratoires japonais Eisai et américains Biogen, représentait un espoir considérable pour les malades et leurs proches. Lors des essais cliniques, le Leqembi avait montré sa capacité à ralentir légèrement le déclin cognitif en éliminant les plaques bêta-amyloïdes qui s’accumulent dans le cerveau des patients atteints de la maladie.
Un bénéfice jugé insuffisant face aux risques
L’accès précoce permet normalement aux patients d’accéder gratuitement à de nouveaux traitements avant la fin des négociations sur leur prix et leur remboursement. Mais pour le Leqembi, la HAS a estimé que « la mise en œuvre du traitement peut être différée, compte tenu d’une efficacité modeste considérée comme non cliniquement pertinente pour la maladie, associée à un profil de tolérance préoccupant ».
Concrètement, les autorités sanitaires estiment que les bénéfices observés ne justifient pas les risques importants que présente ce médicament. Les effets indésirables sont nombreux et préoccupants : œdèmes cérébraux, microhémorragies cérébrales et accidents vasculaires cérébraux. Ces complications nécessitent une surveillance médicale très stricte, avec des IRM régulières, ce que la HAS juge « problématique dans l’organisation sanitaire actuelle ».
Des contraintes organisationnelles majeures
L’utilisation du Leqembi imposerait en effet une réorganisation complète du parcours de soins. Avant même de commencer le traitement, les patients devraient subir un test génétique afin de déterminer leur statut vis-à-vis du gène ApoE4, car les personnes homozygotes pour ce gène présentent un risque accru d’effets secondaires graves.
Une fois le traitement commencé, les patients devraient se rendre à l’hôpital toutes les deux semaines pour recevoir leur perfusion intraveineuse. Parallèlement, des IRM cérébrales seraient nécessaires avant la 5e, la 7e et la 14e perfusion, puis à chaque fois qu’apparaîtraient des symptômes suspects : maux de tête, confusion, troubles visuels, difficultés à marcher ou convulsions.
« Sans un accès rapide à ce traitement, la France risque de perdre en attractivité pour de futurs essais, qui pourraient être annulés ou retardés », a prévenu Marion Lévy, directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer, dans un communiqué exprimant sa déception.
Une efficacité modeste sur le déclin cognitif
Les résultats de l’étude pivotale CLARITY-AD, menée sur 1 795 patients, montrent en effet des effets limités. Après 18 mois de traitement, le Leqembi ralentit le déclin cognitif de 27 % par rapport au placebo. Cette amélioration équivaut à environ neuf mois de déclin « gagnés » sur une période de deux ans.
Si ces chiffres peuvent sembler encourageants, la HAS les juge insuffisants au regard des contraintes et des risques. L’autorité sanitaire souligne également l’absence de corrélation démontrée entre la réduction des dépôts amyloïdes dans le cerveau et l’amélioration clinique réelle des patients.
La Commission de la transparence a également noté que « la qualité de vie n’a pas été évaluée de manière suffisamment rigoureuse » et que les données d’efficacité proviennent « d’une seule étude de phase III dont les résultats ne sont pas cliniquement pertinents ».
L’expérience contrastée des autres pays
Cette décision française contraste avec les choix faits par d’autres pays européens. L’Allemagne et l’Autriche ont déjà autorisé le Leqembi dans le cadre d’un accès contrôlé, tandis que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et l’Italie poursuivent leurs évaluations.
Aux États-Unis, où le médicament est disponible depuis janvier 2023, il coûte environ 22 000 euros par an et par patient. Ce prix exorbitant soulève des questions quant à l’accessibilité du traitement, même en cas de prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie.
Suivez toute l’actualité d’auravita sur Flipboard, ou recevoir directement dans votre boîte mail avec Feeder.
Les associations de patients en première ligne
La Fondation France Alzheimer a exprimé sa déception face à cette décision, qu’elle qualifie de « coup dur pour les malades ». Les associations rappellent que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ne disposent aujourd’hui d’aucun traitement efficace, les quatre médicaments précédemment disponibles ayant été déremboursés en 2018, la Haute Autorité de santé (HAS) ayant jugé leur service médical rendu insuffisant.
« La Fondation Vaincre Alzheimer regrette que cette avancée scientifique majeure ne se traduise pas plus rapidement en un accès concret pour les malades, et appelle les instances à davantage de cohérence dans leur soutien à la recherche et à l’innovation », peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.
Un sondage réalisé par la même fondation auprès de malades et de leurs proches révèle que 47 % des personnes interrogées accepteraient ce traitement malgré ses risques. Ce chiffre monte à 73 % en incluant les réponses « peut-être ».
Un second examen est prévu
Tout espoir n’est cependant pas perdu pour les patients et leurs proches. La Haute Autorité de santé (HAS) doit en effet rendre un second avis sur le remboursement du Leqembi dans les prochains mois, entre octobre et novembre 2025. Cette nouvelle évaluation portera spécifiquement sur l’inscription du médicament sur la liste des spécialités remboursables.
Les enjeux dépassent le simple cadre médical. Cette décision fait suite au lancement de la stratégie nationale sur les maladies neurodégénératives, qui vise notamment à améliorer la prise en charge des patients et à renforcer la recherche. Le refus d’accès au Leqembi semble aller à l’encontre de ces objectifs.
Les professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer sont partagés. Certains soulignent l’importance d’avoir enfin un traitement agissant sur les mécanismes de la maladie plutôt que sur ses seuls symptômes. D’autres estiment toutefois que les contraintes organisationnelles et les risques sont trop importants pour un bénéfice aussi modeste.
Cette controverse illustre la difficulté de trouver un équilibre entre l’espoir légitime des patients et de leurs proches et l’exigence de sécurité sanitaire des autorités. Elle soulève également la question plus large de l’accès à l’innovation thérapeutique dans un système de santé aux ressources limitées.